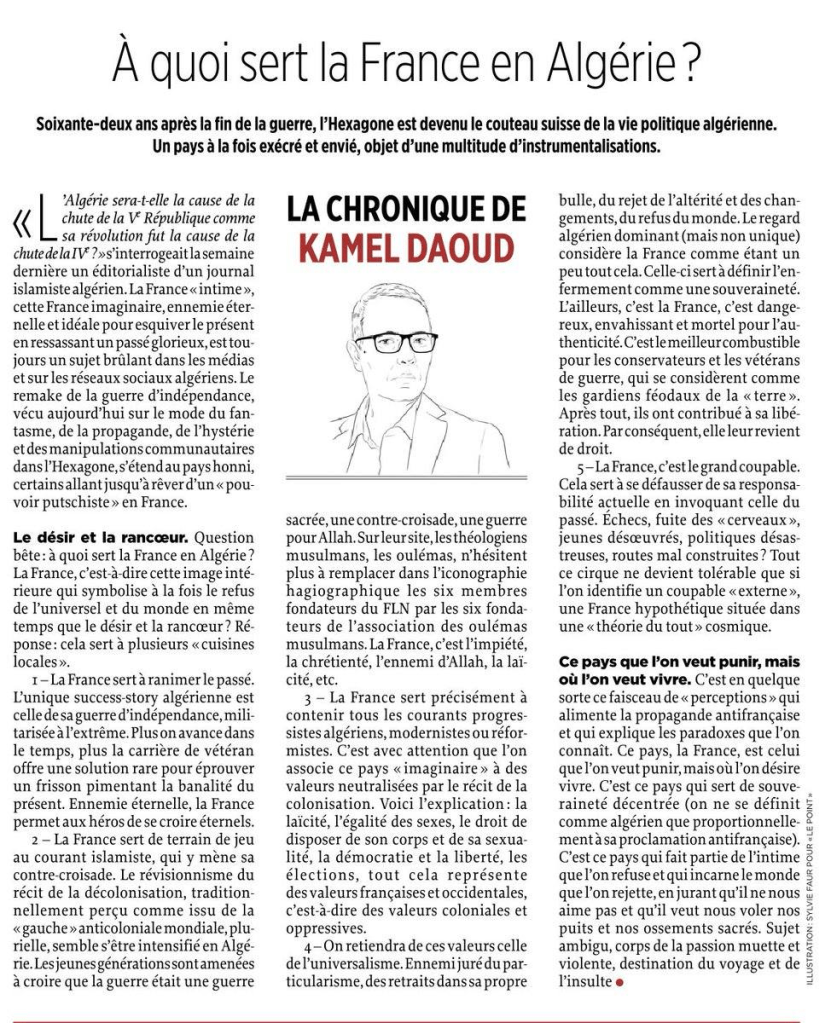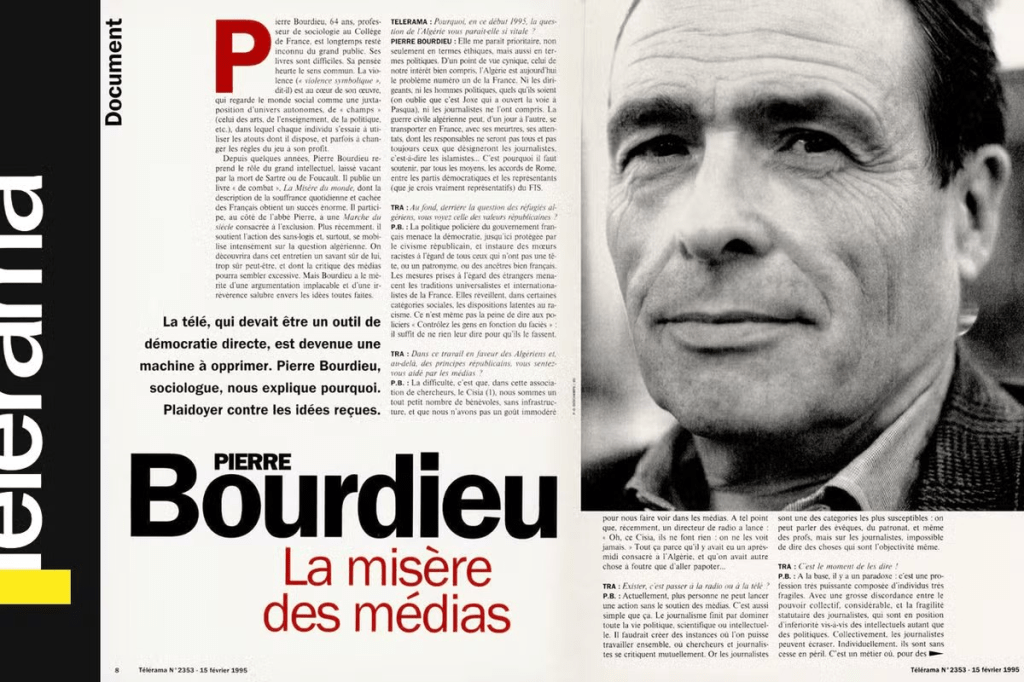Elle s’éveilla sans bouger. À peine un souffle, à peine un bruit. Ce n’était ni la lumière ni la voix intérieure qui la tirait du sommeil, mais cette sensation diffuse, instinctive, presque animale : une odeur. Les lieux s’imposent d’abord par le nez. Avant même d’ouvrir les yeux, elle savait où elle était, ou du moins où elle avait été. L’odeur salée d’un balcon tourné vers la Méditerranée, le goût du vent chaud, légèrement iodé, qui colle à la peau et s’incruste dans les cheveux. Cette odeur-là n’a pas besoin de lieu, elle est le lieu. Tout comme l’huile chaude d’une ruelle d’Alger, mêlée au sucre et à la pâte qui frémit dans la friture du matin. On y reconnaît la Casbah avant même d’y mettre les pieds. À des milliers de kilomètres de là, dans la géométrie froide des malls de Dubai, ce sont les notes persistantes de santal et de patchouli qui tissent le décor, la climatisation sèche qui donne au luxe cette allure chirurgicale, distante. Et puis il y a Washington, ses trottoirs lissés, ses arbres parfaitement taillés, et ce parfum de cherry blossom, trop doux, trop propre, presque faux dans sa perfection. C’est toujours l’odeur qui précède le monde.
À ses yeux, l’odeur ne se contentait pas de décrire un lieu, elle en construisait la mémoire. Elle façonnait les émotions, dictait l’humeur des jours. Une journée pouvait être douce ou douloureuse selon ce que l’on respirait au moment de l’ouvrir. Rien n’était plus fiable, plus direct, plus intime. Le cœur était trop symbolique, les souvenirs trop construits, alors qu’un parfum ressuscitait un instant entier sans détour. Une bouffée et tout remontait. Une autre, et tout s’effondrait. Le corps se souvenait avant elle.
Elle se rappelait cette ville perchée sur la Méditerranée, où les soirées n’étaient qu’un prolongement muet de l’après-midi. Le soleil s’était retiré, oui, mais la chaleur demeurait, collée aux murs des maisons en pierre, suspendue aux rideaux que le moindre souffle d’air ne suffisait pas à soulever. Dans ce calme épais, les chiens, épuisés, gardaient les yeux mi-clos, allongés dans les angles d’ombre. Rien ne faisait bruit, sinon le générique diffusé par tous les postes de télévisions du quartier : Le riche et le pauvre, un feuilleton devenu rite nocturne, que chacun suivait sans le dire, en silence, à travers les fenêtres entrouvertes. C’est de cette ambiance suspendue qu’un souvenir précis remontait : une nuit particulière, elle avait suivi son grand frère jusqu’à l’épicerie du coin. Il y avait acheté une bouteille de Hammoud Boualem glacée. Une bouteille en verre sombre, perlée de gouttelettes, qui brillait sous les lampadaires comme une promesse d’ailleurs.
Elle se souvenait de la difficulté à suivre ses pas. Il allait vite, lui. Il voulait rentrer avant la fin du générique, et elle, elle courait à petits pas, s’appliquant à ne pas le perdre, à ne pas rester seule dans cette nuit qui ne lui appartenait pas. Ce n’était pas dans ses habitudes de sortir après le coucher du soleil. La chaleur nocturne, étrange, presque hostile, ajoutait au vertige de cette escapade. Mais ce qu’elle n’a jamais oublié, ce sont les lumières. Suspendues aux fenêtres, sans logique ni symétrie, elles semblaient respirer doucement. Et surtout, il y avait l’odeur du jasmin de nuit. Un parfum dense, presque liquide, qui s’enroulait autour des jambes, remontait jusqu’aux tempes, laissait dans l’air comme une mélodie invisible. Ce n’était ni un détail ni un décor. C’était le centre. L’odeur avait rendu cette nuit inoubliable, alors même qu’elle n’en avait compris ni l’enjeu ni le sens.
Des années plus tard, elle continuait à dénombrer les premières lumières du soir, comme on consulte les signes d’un monde intérieur. Ce geste, devenu réflexe, était une manière de se relier à ce qui avait été. Elle n’aurait su dire si cela relevait d’un besoin, d’une habitude ou d’un attachement plus profond. Regarder les fenêtres qui s’allumaient dans les rues de Soho ou celles, plus rangées, de Georgetown, relevait du même rituel que dans l’enfance. À travers ces halos jaunes ou bleutés, elle ne cherchait pas à deviner les visages ni les histoires, seulement à sentir que la vie continuait, là, quelque part, même si ce n’était plus la sienne. Chaque lumière derrière une vitre, chaque rideau entrouvert, était un battement, un signe discret, un je suis encore là. Il n’y avait rien à expliquer, rien à rationaliser. Elle regardait, elle sentait, et cela suffisait à maintenir le fil.
À tous ces souvenirs d’enfance s’était greffé, ces dernières années, le spectacle familier du métro aérien qui serpentait face à la fenêtre de sa cuisine. De jour comme de nuit, elle observait le va-et-vient régulier des rames, comme on écoute le ressac. Ce n’était pas seulement des wagons qui passaient, mais tout un échantillon de vies humaines, confortablement assises, absorbées, peut-être, par leurs écrans ou leurs pensées. Le soir, les silhouettes se détachaient plus nettement à travers les vitres, dessinant un théâtre d’ombres en mouvement. À la fréquence des trains ou à la densité des voyageurs, elle savait reconnaître l’heure, parfois même le jour de la semaine. Les week-ends, les passages étaient plus espacés, les compartiments plus clairsemés. La nuit, les visages devenaient rares, les trajets silencieux.
Il y avait aussi les voisins, discrets mais constants, qui promenaient leurs chiens à toute heure, foulant le gazon impeccablement tracé. Ils ramassaient méthodiquement les déjections des petites bêtes, comme on efface chaque jour la trace d’un passage. Ce quartier, voilà près de vingt ans qu’elle y avait déposé ses valises. Elle qui avait longtemps vagabondé, de continent en continent, de villes en villes, d’appartements huppes en maison de ville cossue, elle avait fini par pousser la porte en bois de la maison bleue. Elle n’y avait pas cru tout de suite. Il lui avait fallu du temps pour admettre qu’elle avait atterri, enfin. Mais à force de lumières guettées, de parfums familiers, de métros comptés et de chiens connus par cœur, le lieu avait fini par l’absorber doucement, comme une terre reconnaîtrait enfin son exilée.