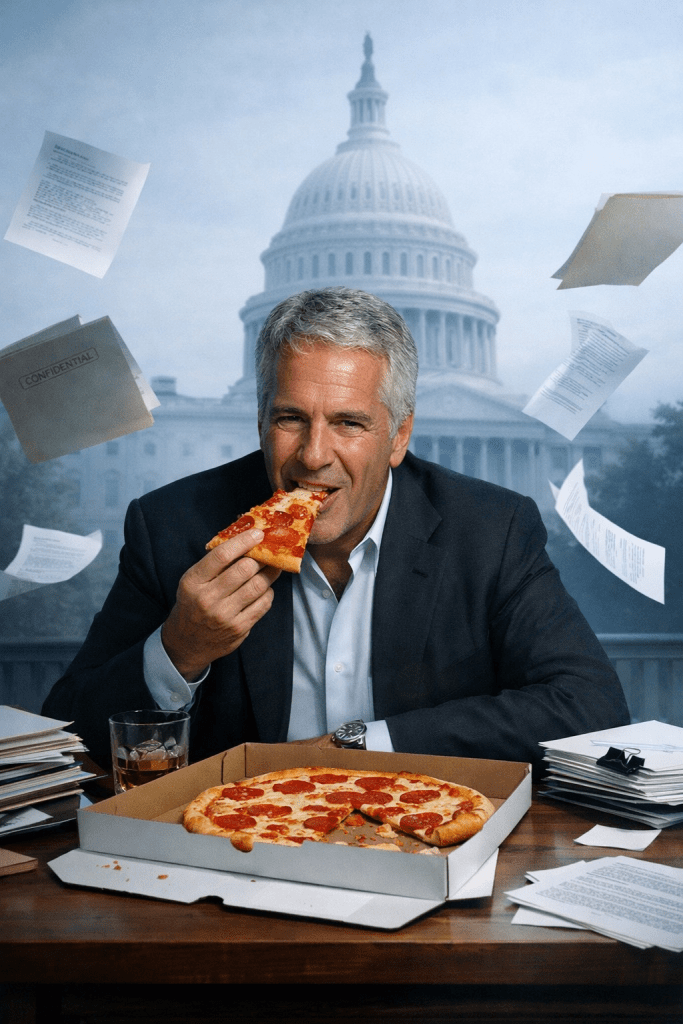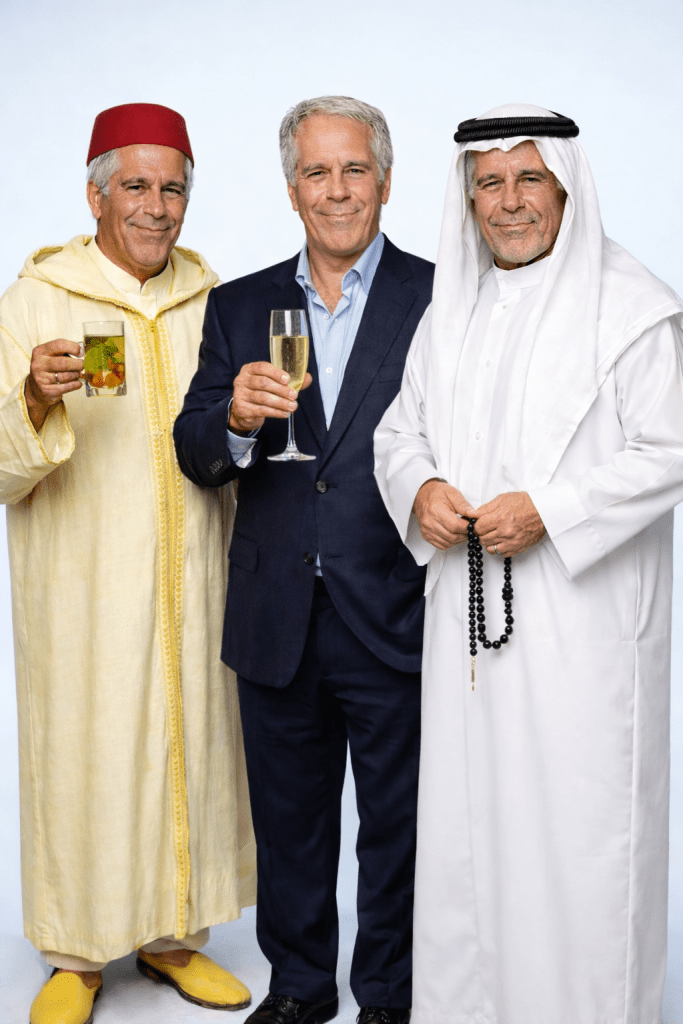Au Maroc, les réseaux d’Epstein ne relèvent plus de la périphérie mais se cooptent et se structurent. Jeffrey Epstein y trouve des connexions établies. Jack Lang y entretient depuis longtemps des accès diplomatiques assumés. Fabrice Aidan, lui, y déploie son influence au croisement de l’énergie, de la diplomatie et des institutions internationales.
Mardi 10 février, la presse internationale citait Aidan dans les « Epstein Files ». Le soir même, le ministère Français des Affaires étrangères annonçait la saisine de la justice concernant ce diplomate aux multiples correspondances avec le milliardaire mort en 2019. La question n’est plus celle d’un nom isolé mais celle d’une convergence.
Un environnement relationnel déjà structuré
Jeffrey Epstein a entretenu des relations documentées avec des personnalités du premier cercle politique du Roi Mohamed 6. Ces liens sont attestés par des archives et des publications de presse. Ils relèvent d’un réseau d’accès de haut niveau.
Dans le même temps, la proximité ancienne-actuelle et assumée de Jack Lang avec le Makhzen marocain n’a jamais constitué un secret diplomatique. Il a toujours été qestion d’une relation politique et culturelle durable entre Paris et Rabat.
Precisons toutefois que ces éléments ne sont pas des accusations. Ils décrivent un environnement élitaire déjà structuré avant l’apparition du nom de Fabrice Aidan.
La trajectoire Aidan : diplomatie, énergie et accès stratégique
Fabrice Aidan débute sa carrière comme diplomate Français aux Nations Unies à New York. Il rejoint ensuite le secteur privé au sein d’ENGIE dans des fonctions internationales.
Selon des souces mediatiques, Aidan apparaît dans près de 200 fichiers des « Epstein Files » et est présenté comme « l’homme d’Epstein au cœur du deal OCP-Engie – OCP:Office Chérifien des Phosphates + ENGIE: un groupe énergétique Français multinational».
Lors de la visite d’État Française au Maroc en octobre 2024, Aiden multiplie les rencontres avec les dirigeants d’ENGIE et les responsables Marocains dont Leïla Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable du Maroc, autour de projets énergétiques structurants, notamment en lien avec l’Office Chérifien des Phosphates.
Une source diplomatique citée précise qu’il « avait ses entrées partout durant la visite d’État, car proche d’Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du Président français ».
La coopération énergétique franco-marocaine est stratégique et institutionnalisée mais l’imbrication des réseaux interroge.
La dimension institutionnelle et symbolique
Precisons qu’entre 2017 et 2025, Audrey Azoulay dirigeait l’UNESCO. Elle est la fille d’André Azoulay, conseiller historique des Rois Hassan 2 et Mohamed 6.
Par ailleurs, l’UNESCO incarne la défense de l’enfance et la protection des patrimoines humains. Dans ce contexte, la présence d’un diplomate Français cité dans les « Epstein Files » au sein de réseaux connectés à cette sphère internationale met en évidence une contradiction majeure : Fabrice Aidan cité comme prédateur sexuel mondial évolue dans des cercles où la protection des mineurs est une valeur centrale.
En effet cela ne constitue pas une mise en cause institutionnelle. Mais cela révèle la porosité des circuits d’influence entre diplomatie, culture et pouvoir.
Un enchevêtrement devenu structurel
Et combien meme il ne s’agit point d’accuser un État. Restes qu’il est surtout question de constater un enchevêtrement.
Lorsque les mêmes réseaux traversent diplomatie, énergie, organisations multilatérales et relations bilatérales de haut niveau, la question cesse d’être marginale. Elle devient structurelle.
Oui, la justice établira les responsabilités individuelles mais l’analyse stratégique impose déjà une interrogation claire. Celle de comment des circuits d’influence aussi concentrés, aussi documentés, peuvent-ils fonctionner sans déclencher une vigilance internationale renforcée ?
Last not least.
Non, la piste Marocaine ne relève pas d’un récit spéculatif. Elle repose sur des faits publiés et des interactions documentées. Jeffrey Epstein a séjourné à plusieurs reprises à Marrakech selon le journal Marocain Le Desk qui signale ses correspondances et contacts avec des personnalités Françaises évoluant dans des sphères liées au Maroc. Jack Lang entretient depuis des décennies une proximité assumée avec les plus hautes autorités Marocaines. Audrey Azoulay alors directrice générale de l’UNESCO et fille d’André Azoulay conseiller historique des Rois Hassan II puis Mohammed VI représente un point de jonction entre diplomatie culturelle Française et pouvoir Marocain.
Dans ce paysage relationnel déjà structuré apparaît Fabrice Aidan. Diplomate aux Nations Unies puis cadre chez Engie il est cité dans les « Epstein Files » et présenté par Le Desk comme intervenant dans des dossiers stratégiques liés au partenariat entre l’OCP et le groupe énergétique Français.
Le Maroc n’est pas en marge du dossier. Il constitue un point de croisement où Epstein séjourne, Lang est ancré, Azoulay incarne la continuité institutionnelle et Aidan circule entre ces sphères tout en figurant dans les « Epstein Files ».
La convergence n’est plus contestable et elle est installée. Il reste à comprendre comment ces cercles d’influence ont pu se déployer au cœur du Maroc et structurer cette architecture relationnelle.